Revenances de l’histoire
Entretien avec Jean-François Hamel
Revenances de l’histoire. Répétition, narrativité, modernité.
Paris, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2006, 234 p.
par Dominique Garand
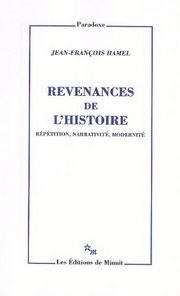 Dominique Garand – Jean-François Hamel, l’essai que vous publiez aux Éditions de Minuit étonne par le tissage serré des nombreuses thématiques qui le sillonnent (l’histoire, la narrativité, la répétition, la modernité, les spectres ou revenants, la mélancolie, la temporalité, la mémoire et l’oubli, l’éternel retour, etc.), de même que par l’abondance et la disparité des références convoquées, qu’elles soient théoriques (Benjamin, Marx, Nietzsche, Freud, Rancière, Ricœur) ou littéraires (Hugo, Michelet, Baudelaire, Klossowski, Simon, Michon, etc.). Quelle intuition fondamentale serait à la base de votre investigation ?
Dominique Garand – Jean-François Hamel, l’essai que vous publiez aux Éditions de Minuit étonne par le tissage serré des nombreuses thématiques qui le sillonnent (l’histoire, la narrativité, la répétition, la modernité, les spectres ou revenants, la mélancolie, la temporalité, la mémoire et l’oubli, l’éternel retour, etc.), de même que par l’abondance et la disparité des références convoquées, qu’elles soient théoriques (Benjamin, Marx, Nietzsche, Freud, Rancière, Ricœur) ou littéraires (Hugo, Michelet, Baudelaire, Klossowski, Simon, Michon, etc.). Quelle intuition fondamentale serait à la base de votre investigation ?
Jean-François Hamel – Cet essai se propose de concilier l’interrogation théorique et l’enquête historique pour mieux comprendre l’actualité d’une pratique vieille comme le monde. Malgré la disparité de ses thèmes, qui n’est qu’apparente, l’essentiel de cet essai concerne l’art de raconter et son rapport à la modernité des deux derniers siècles. Ne s’inscrivant pleinement ni en narratologie ni en histoire, ni en philosophie ni en sociologie, mes Revenances sont sans doute un peu à l’image de ces âmes errantes qui ne cessent de franchir les frontières entre les mondes. Il ne s’agit cependant ni d’une mosaïque d’analyses éparses ni d’un simple bricolage de théories.
D’abord, il s’agissait de rendre justice au travail lumineux de Paul Ricœur dans les trois tomes de Temps et récit, ouvrage qui demeure plus de vingt ans après sa publication la tentative de conceptualisation la plus riche des rapports entre la temporalité vécue et sa transposition langagière. Mais penser avec Ricœur, c’était aussi oser penser contre lui. Or il m’a semblé que l’inspiration herméneutique de Temps et récit, essentiellement gadamérienne, en venait à minimiser l’historicité des pratiques narratives en les indexant à une tradition pérenne. D’Homère et Hérodote à Joyce et Braudel, les manières de raconter se seraient maintenues, du moins en Occident, dans le cadre d’un même paradigme dont la Poétique d’Aristote représenterait la première formulation théorique. Mon dessein consistait à questionner ce principe de continuité transhistorique en m’inspirant des recherches contemporaines qui ont démontré la transformation des expériences du temps au fil de l’histoire. Du constat désormais largement partagé d’une historicité des formes de l’expérience découle mon hypothèse d’une historicité des modes de mise en intrigue. En clair, je me proposais de prendre au sérieux la dialectique entre temps et récit chez Ricœur, mais en la soumettant à un examen critique et historique. Ne peut-on pas croire que si l’expérience du temps se transforme d’époque en époque, les manières de raconter subissent de semblables mutations? Voilà mon point de départ.
Une fois cette hypothèse énoncée, il me fallait la mettre à l’épreuve d’un corpus à la fois assez ouvert pour soutenir une réflexion sur la narrativité moderne et suffisamment homogène pour en tirer quelques enseignements. Prolongeant une intuition de Walter Benjamin, je me suis intéressé à la résurgence des temporalités cycliques dans la modernité. On en connaît bien les avatars philosophiques, de Kierkegaard à Heidegger, en passant par Marx et Nietzsche. On évoque moins souvent sa contrepartie littéraire, dont Klossowski et Simon sont les représentants les plus fascinants. Ma question était toute simple : pourquoi, depuis le milieu du xixe siècle, dans des sociétés dont l’imaginaire historique repose sur la linéarité irréversible et cumulative du temps, a-t-on vu resurgir, en philosophie et en littérature, une temporalité aussi archaïque que l’éternel retour? Comment expliquer cette mise en récit de la répétition des événements et des êtres en plein cœur d’une modernité rêvant de progrès? Ce phénomène étrange de l’histoire de la narrativité m’a semblé témoigner d’un sentiment de crise, qui s’exprime entre autres par une ambivalence à l’égard de toute figure d’héritage. Face à une nouvelle expérience du temps historique, marquée par un fort coefficient de discontinuité, la narrativité moderne a tenté de se redéfinir en se détachant en partie des pratiques traditionnelles du récit. Les fantômes et les spectres qui traversent les textes de Marx, Hugo, Nietzsche, Klossowski et Simon disent une rupture de la tradition et illustrent le retour du récit sur lui-même qui permet de la porter au langage. La « revenance » de l’éternel retour depuis deux siècles signalerait donc un malaise dans la narrativité, qui serait l’effet de l’inquiétude propre à une certaine expérience moderne de l’histoire. En somme, à une transformation de l’expérience du temps aurait répondu une transformation des manières de raconter. Les poétiques de la répétition me paraissent très clairement en porter les signes.
C’est là où je reviens à ma critique de Ricœur, qui n’est que l’envers d’une dette. La résurgence moderne des temporalités cycliques et des poétiques de la répétition rend compte d’une crise du paradigme aristotélicien auquel Temps et récit restait attaché. C’est l’inquiétude liée à l’accélération de l’histoire et à la différenciation des sociétés modernes, dont Walter Benjamin et Hannah Arendt avaient très tôt pris la mesure, que les thèses de Ricœur laissent dans l’ombre
DG – Votre débat avec Ricœur est en effet très substantiel, mais vous l’avez curieusement reporté en conclusion de votre ouvrage. Les premiers chapitres font plutôt intervenir la figure de Benjamin. Est-ce là une stratégie de pensée, ou bien est-ce dû simplement au fait que, comme vous venez de le dire, Benjamin a précédé Ricœur sur cette voie ? Par ailleurs, vous identifiez aussi une certaine forme de blocage faisant plier Benjamin dans l’élaboration de sa réflexion sur la répétition – vous soutenez à ce sujet qu’il n’aurait pas totalement rendu justice aux avancées de Baudelaire. L’aporie que vous observez chez Benjamin est-elle de même nature que celle épinglée chez Ricœur?
JFH – Il est vrai que je fais jouer Benjamin contre Ricœur dans ma discussion des rapports entre tradition et narrativité. Les raisons en sont simples. Dans « Le narrateur », Benjamin identifie une mutation des arts du récit au seuil de la modernité, mutation qui résulte de plusieurs transformations sociales et surtout du bouleversement de l’expérience du temps qu’elles ont entraîné. Il soutient que le passage d’une expérience vécue dans le creuset de la tradition à une expérience mettant sans cesse en jeu de nouvelles inconnues et supposant un rapport problématique au passé ne peut que contraindre la narrativité à se transformer. Si vous me permettez de faire appel à la terminologie de François Hartog (elle-même inspirée des travaux fondateurs de Reinhart Koselleck), je dirai que Benjamin diagnostique le passage du régime ancien au régime moderne d’historicité et tente de saisir son impact sur les pratiques narratives. C’est ce bouleversement de l’expérience du temps et ses conséquences sur la narrativité que Ricœur, notamment dans un chapitre comme « Les métamorphoses de l’intrigue » (Temps et récit. 2. La configuration dans le récit de fiction, 1984), tend à dénier. Dans ce même chapitre, Ricœur a tôt fait d’écarter les propositions de Benjamin en n’y voyant que la prophétie catastrophiste d’un déclin irréversible de l’art de raconter. La thèse de Benjamin est à vrai dire plus nuancée : certaines pratiques narratives se perdent en raison de l’apparition d’une nouvelle expérience du temps, mais d’autres émergent, qui affrontent la situation nouvelle en y répliquant par un effort d’invention et d’innovation.
Permettez-moi une parenthèse. La rupture de la tradition provoquée par la modernisation ne doit pas être sous-estimée. Un historien comme Jacques Le Goff a pu la décrire par l’idée d’un « long Moyen-Âge » qui désigne une civilisation européenne s’étendant sur près de quinze siècle et présentant de très fortes constantes démographiques, idéologiques et technologiques, puis disparaissant en quelques décennies au xixe siècle. De manière plus imagée, l’anthropologue André Leroi-Gourhan écrivait qu’un observateur extérieur à l’humanité, s’il pouvait comparer un homme de la Renaissance et un homme du xxe siècle, aurait sans doute l’impression de faire face à deux espèces animales tant leurs modes de vie sont différents. On peut croire que l’ampleur des transformations qui ont touché l’Occident moderne n’ont pas épargné le récit, qui est une pratique sociale et dont les déterminations sont principalement historiques.
En ce qui concerne le rapport de Benjamin à Baudelaire, je ne l’envisage que sous l’aspect de l’expérience du temps, laissant de côté la question de la poésie lyrique. Et j’y observe en effet une aporie. Benjamin suggère qu’une corrélation existe entre le concept de l’éternel retour nietzschéen, la théorie d’une répétition de l’histoire développée par Blanqui et la dialectique du spleen et de l’idéal chez Baudelaire. L’hypothèse peut paraître saugrenue, mais elle est éclairante, comme je tente de le démontrer dans le deuxième chapitre de mon essai. Cependant, la double valeur que Benjamin accorde à la répétition chez Blanqui, comme image spéculaire d’une société médusée par son passé et comme résistance politique à une sclérose de la mémoire, ne se retrouve pas dans ses analyses de l’expérience baudelairienne du temps. Ma stratégie consiste alors à rendre lisible chez Baudelaire ce que Benjamin méconnaît du fait de son rejet sans appel du « Peintre de la vie moderne ». Dans ce texte, Baudelaire développe une pensée de la modernité extrêmement riche, qui repose sur l’appel à une « mémoire du présent ». C’est cette mémoire du présent, qui existe d’ailleurs sous une forme analogue chez Nietzsche, qui me paraît faire signe à une narrativité qui prendrait acte de la rupture de la tradition sans céder aux sirènes de l’avenir ni se complaire dans le ressassement mélancolique. Je vous disais plus tôt que penser avec Ricœur, c’est aussi, quand il le faut, penser contre lui. De même, penser avec Benjamin, ce n’est pas se borner à en reconduire le propos.
Cela dit, ma critique de Ricœur n’a que peu à voir avec ma critique de Benjamin. Dans le premier cas, l’enjeu, à la fois théorique et historique, concerne les rapports de la modernité à la tradition. Dans le second cas, il s’agit de retraverser une lecture de Baudelaire qui a fait date, à juste titre d’ailleurs, et d’en isoler un point de cécité, non pour dévaluer le travail de Benjamin, mais plutôt pour en prolonger les intuitions. Enfin, si ma critique de Temps et récit est reportée en conclusion, c’est simplement qu’elle découle des analyses antérieures, qui la soutiennent. J’ai cru bon de procéder à un parcours historique, ponctué par des études de cas, avant d’énoncer mes conclusions théoriques. La théorie n’a d’utilité que si elle donne à penser au-delà d’elle-même, mais les objets qu’elle permet de mieux comprendre doivent la nourrir en retour.
DG – Votre investigation théorique débouche sur une prise de position très nette en faveur d’une littérature capable de faire son deuil des régimes anciens d’historicité (qui prévoyaient une transmission de l’expérience par le biais de traditions et assuraient donc une continuité entre le passé, le présent et le futur). Vous soutenez que les récits les plus significatifs aujourd’hui sont ceux qui rejouent (ou reprennent, au sens kierkegaardien du terme) ce que vous appelez «la rupture inaugurale de la modernité», c’est-à-dire ce moment à partir duquel le passé n’est plus le garant du présent, ni même son fondement, mais ne peut que lui revenir. En définitive, vous défendez une poétique qui s’acquitte du passé en le réinterprétant sans cesse. Faites-vous du présent le seul temps loisible, le passé devenant dans cette perspective non plus une concrétion de faits inamovibles pesant de tout leur poids, mais bien plutôt un fonds dans lequel la «mémoire du présent» puiserait de nouvelles configurations ?
JFH – Quelques mots d’abord sur la portée éthique de cet essai et, puisqu’il en va du temps de l’histoire, sur sa dimension politique. Je crois important d’y revenir, comme m’y invite votre question, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas si fréquent aujourd’hui que les littéraires s’aventurent dans ces parages. Jean-Pierre Faye (Théorie du récit, 1972) et Michel de Certeau (L’Invention du quotidien, 1980) étaient parvenus à forcer ce passage, mais leurs réflexions sur le récit n’ont guère eu d’échos chez les chercheurs intéressés à la littérature. Plus récemment, Jacques Rancière (Les Noms de l’histoire, 1992) a aussi contribué à ce débat en analysant la politique du récit qui soutient l’historiographie moderne. Dès que l’on considère le récit comme un phénomène social, je ne crois pas que l’on puisse légitimement en évacuer les aspects stratégiques et tactiques. À mon sens, il faut reconnaître avec Michel de Certeau que l’art du récit est un « art de faire » autant qu’un « art de dire », précisément parce que les histoires sont des répertoires d’actions. Non seulement le récit rapporte-t-il des actions passées, réelles ou fictives, mais il peut ouvrir l’espace de leur actualisation en se constituant comme un recueil de gestes imaginables, de conduites possibles, de pratiques envisageables. Il y a une puissance des récits qui ne se réduit pas au filtre qu’ils imposent à la mémoire. Leur puissance est aussi une puissance de faire l’histoire orientée vers l’avenir. Voilà, de manière trop schématique sans doute, le cadre général dans lequel s’inscrit ce que vous appelez ma « prise de position ». Mais cette dimension de mon travail dépend d’analyses longues, que je ne peux ici qu’évoquer.
Ce qui se dégage du Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte de Marx, du Baphomet de Pierre Klossowski et des Géorgiques de Claude Simon, c’est en effet un travail du deuil à l’égard de l’expérience du temps telle qu’elle pouvait être vécue au sein des régimes d’historicité antérieurs aux xixe et xxe siècles. Cependant, et cette remarque est essentielle, faire le deuil d’un certain rapport à la tradition ne consiste pas à faire table rase du passé. Certes, la métaphorique du fantôme et du revenant qui traverse les premières pages du Dix-huit brumaire, que Derrida avait d’ailleurs mis en lumière dans Spectres de Marx, suggère un poids du passé dont il faudrait s’émanciper. Mais ce récit historiographique d’une très grande complexité ne condamne pas la rétrospection historique; il distingue des usages du passé selon leurs effets sur le présent de l’histoire. Autrement dit, Marx cherche comment écrire le passé sans donner à lire le présent comme sa conséquence nécessaire, sans retirer aux vivants le sentiment d’une possible inflexion du cours du monde. Chez Klossowski, la rupture de la tradition est représentée par la mort de Dieu, d’où s’élève une interrogation fondamentale : comment raconter le passé sans l’idée d’une unité sans reste de l’histoire, idée que seule pouvait soutenir la foi en une providence divine et en une certaine ruse de l’histoire? Et comme Marx, Klossowski se refuse à rejeter le passé; il s’emploie plutôt à transformer les schèmes narratifs hérités de la tradition chrétienne pour les rendre aptes à dire l’expérience d’un désenchantement du monde, pour les amener à témoigner d’une expérience moderne pour laquelle passé, présent et avenir ne font plus corps. Dans Les Géorgiques, c’est la Révolution française qui figure une fracture du temps historique au seuil de la modernité. Tout le roman réfléchit cette violence infligée à la tradition et y réplique par une narration dont l’objectif est de restituer la mémoire du passé sans gommer tout ce qui sépare le maintenant de l’autrefois. Aussi différents soient-ils, ces récits prennent tous acte du passage d’un régime d’historicité à un autre et y répliquent en témoignant du sentiment d’une hétérogénéité des temps.
Selon moi, une finalité éthique et politique soutient ces poétiques du deuil. Marx, Klossowski et Simon sont en quête d’une narrativité capable de désigner la différence du présent et du passé de manière à rendre visible le présent comme lieu d’un investissement éthique et politique. L’importance du présent dans ces textes vient, d’une part, de ce qu’il est à strictement parler le temps propre de l’action, et, d’autre part, que les « grands récits » de la modernité, qu’ils soient tournés vers le passé (récits archéologiques) ou vers l’avenir (récits téléologiques), tendent à réduire sa marge de manœuvre en le considérant comme un simple point de passage pour différents contenus d’expérience. Si ces poétiques du deuil ont une finalité éthique et politique, c’est qu’elles résistent aux tentations conservatrices d’un retour au passé tout autant qu’aux velléités progressistes. Elles préservent la contingence du présent et s’inscrivent dans une lutte contre d’autres récits, contre d’autres représentations du temps qui minent la puissance de faire l’histoire. Ces poétiques sont des laboratoires où différentes configurations du temps sont expérimentées selon une même exigence : maintenir l’altérité du présent et ainsi le rendre perceptible comme un espace d’action toujours ouvert.
Contre la dialectique hégélienne et le ressouvenir platonicien, Kierkegaard prônait la reprise du passé qui ouvre le passé à l’avenir depuis le présent. La catégorie philosophique de la reprise, qui relève de l’éthique, illustre bien le rapport à l’histoire que j’associe aux phénomènes de revenance de la narrativité moderne. Reprendre le passé par le récit, mais de telle sorte que le présent diffère de lui-même en direction de l’avenir. S’emparer du passé, non pour le perpétuer à l’identique, mais pour soutenir au présent une altération libératrice des êtres et des choses. La revenance, en tant que reprise, constitue à la fois un deuil du passé et sa ressaisie présente, une assomption de l’histoire antérieure et un dégagement au nom de ce qui reste à venir.
DG – Je partage entièrement votre point de vue lorsque vous affirmez : «Si le roman moderne fait violence à la tradition narrative constituée, c’est d’abord parce que l’expérience du temps a connu une mutation profonde et que les sociétés modernes ont vu s’instaurer un régime d’historicité radicalement différent de celui des communautés antérieures.» (p. 177) Cependant, j’ai l’impression que vous reprenez ici le flambeau des avant-gardes dont le déclin est maintenant consommé, notamment parce que leurs recherches de nouveaux modes narratifs ont cessé d’être assimilables par la grande majorité des lecteurs. Même les «spécialistes» (universitaires, éditeurs, chroniqueurs, etc.) tournent aujourd’hui le dos à l’inévitable illisibilité qu’entraîne cette violence menée contre «la tradition narrative constituée». L’idée d’une «lutte contre d’autres récits, contre d’autres représentations du temps» n’est envisageable que si l’échiquier social réserve encore une place à ces prises de parole singulières. Les expériences dont vous défendez la pertinence éthique, politique et esthétique, sont-elles destinées à demeurer marginales ou bien voyez-vous qu’elles puissent infiltrer le discours social dominant d’une quelconque manière ?
JFH – Je ne crois pas à ce que vous appelez « l’inévitable illisibilité » des récits qui réfléchissent la rupture de la tradition et en font un moteur d’innovation et d’invention. La valeur d’illisibilité d’un texte ne peut être que relative, puisqu’elle est toujours historiquement située : elle dépend d’un horizon d’attente, par nature variable, comme l’a montré l’esthétique de la réception. Il est vrai cependant que des récits comme Le Baphomet ou Les Géorgiques paraissent difficiles, mais leur relative opacité ne me paraît pas supérieure à l’opacité de L’Éducation sentimentale de Flaubert pour ne donner que cet exemple. Je ne crois pas non plus que les lecteurs spécialisés tournent le dos à ce type de littérature; et s’ils le faisaient au nom d’une vague idée de démocratisation de la culture (vous laissez en effet entendre qu’il faudrait suivre les choix de « la grande majorité des lecteurs »), nous assisterions sans doute à l’épisode ultime de la « dévalorisation » de la littérature que William Marx a étudiée dans L’Adieu à la littérature. Et si les éditeurs et les journalistes se détournent d’une littérature plus exigeante, il faudrait en identifier les causes, qui sont sans doute de nature sociale et économique. Quoi qu’il en soit, il n’y a rien là qui ait valeur de prescription, et il est trop tôt pour prétendre que ce tournant soit irréversible.
Surtout, on doit distinguer chez les écrivains modernes l’appel de la nouveauté pour elle-même, qui confine parfois à un certain formalisme, et l’effort plus ou moins conscient pour adapter les formes de la littérature à des réalités historiques inédites et qu’il paraît difficile de représenter par la simple reconduction des formes héritées. À cet égard, l’œuvre de Claude Simon me semble exemplaire : ses expérimentations, qui n’ont rien d’arbitraires, portent au langage une expérience temporelle profondément ancrée dans l’histoire européenne du xxe siècle. Bien avant la vague des études culturalistes sur le trauma et l’indicible, Simon a mis en lumière la difficulté d’une certaine tradition narrative à dire la violence des conflits qui ont secoué le continent. Par là, il a aussi éclairé les processus mnémoniques d’une conscience désorientée, blessée, traquée. La mise à mal des manières anciennes de raconter ne vient pas chez lui d’une pure volonté de distinction, d’une simple adhésion esthétique à la « tradition du nouveau », mais elle se constitue plutôt comme une réplique à transformation radicale des cadres de l’expérience. De même, de larges pans de ce que l’on a pu appeler les « avant-gardes » provenaient d’une réaction au monde dans lequel leurs représentants avaient été projetés. Ils n’y réagissaient pas seulement comme écrivains, c’est-à-dire en regrettant le peu de reconnaissance sociale dont on les gratifiait ou en se donnant pour projet de dépasser leurs prédécesseurs pour entrer à leur tour dans la généalogie des grands maîtres. Plusieurs y réagissaient aussi comme des sujets de l’histoire, héritiers de ses déchirements et de sa violence, dépositaires d’une exigence de témoignage et de résistance.
Quant à savoir si ces pratiques narratives nouvelles peuvent s’introduire dans le discours social, orienter des conduites éthiques et produire des subjectivations politiques, il n’y a pas de réponse facile. La littérature et les arts se disséminent dans l’espace de la société selon des rythmes divers, selon des durées plus ou moins longues, à travers des structures complexes et changeantes. Mais comme le disaient autrefois les formalistes russes, la littérature et les arts peuvent défamiliariser notre rapport au monde : ils peuvent aussi relativiser les récits qui guident nos vies, et, en cela, mettre en lumière les modes d’historicité des sujets éthiques et politiques que nous sommes. Si je ne crois pas à une autonomie complète des pratiques et des productions esthétiques, je ne me leurre pas non plus sur leurs effets sociaux : il n’y a pas plus de frontière tranchée entre l’art et la vie qu’il n’y a de passage immédiat entre eux. D’ailleurs, la question n’est peut-être pas là. En ce qui concerne mon travail, je tiens à rappeler qu’un récit n’existe jamais seul, tout comme un texte est tissé d’intertextes divers et de discours multiples. On n’écrit qu’immergé dans d’autres écritures, et on ne raconte des histoires qu’au contact de certaines autres histoires, pour les poursuivre, les déplacer, les dépasser, les contredire. C’est dans les relations conflictuelles entre des récits divergents, dans les tensions irrésolues que manifestent entre elles les dictions et les fictions du temps, dans les écarts entre des configurations distinctes du devenir, que la narrativité comporte des enjeux éthiques et politiques. La narrativité est un espace de lutte et d’affrontement.
DG – En quatrième de couverture, vous situez d’emblée votre réflexion «au-delà de l’analyse du récit appelée naguère narratologie» et au détour d’une phrase, dans votre livre, vous épinglez la cécité qu’aurait manifestée la narratologie structurale (au même titre que les théoriciens du Nouveau Roman) devant le problème de la temporalité. Il est certain que vos analyses se tiennent très loin des données empiriques propres à la narratologie, avec toute cette nomenclature permettant d’identifier les analepses, les prolepses, la durée relative fixant le rapport discours/récit, etc. Cependant, la solidité et la limpidité de vos démonstrations ne conduit pas nécessairement à une perception claire de ce que serait votre «méthode» de lecture. On a l’impression que vous pouvez faire feu de tout bois, c’est-à-dire des indices thématiques autant que des tropes, des descriptions, des parcours narratifs, des commentaires émis par le narrateur, de la construction globale des récits (linéaire ou, au contraire, brouillant les repérages temporels), etc. Bref, portez-vous attention à tous les signes (simples ou complexes) traduisant le rapport au temps ?
JFH – Soyons clairs : je n’ai rien contre la narratologie. En revanche, je n’apprécie guère ce à quoi on la réduit trop souvent. La narratologie a peu d’intérêt si on l’utilise comme une grille de lecture qui permet, sans l’interroger, de maintenir intact le dogme de l’autonomie de l’œuvre et de la clôture du texte. Plus précisément, l’apport de la narratologie est à mes yeux à la fois essentiel et insuffisant. Essentiel, parce qu’on y trouve des précisions terminologiques et notionnelles dont on ne peut faire l’économie, une typologie des formes d’une étonnante richesse et d’une grande valeur. Insuffisant, parce que les phénomènes sociohistoriques qui contribuent à la production des récits n’y occupent aucune place, parce que la « logique » du récit est en grande partie soustraite au temps et à l’histoire. Je ne prétends pas avoir résolu cette tension entre les approches interne et externe, ni avoir élaboré une méthode qui viendrait se substituer à la narratologie et permettrait de corréler une fois pour toutes les pratiques narratives et les expériences du temps. Je n’ai pas cette prétention. Mon travail, comme je le disais, est issu d’une interrogation théorique, mais prend la forme d’une étude de cas. Qu’on n’y cherche pas l’esquisse d’une « méthode » jusqu’alors inconnue.
Je pense néanmoins qu’il faut réintroduire dans les études sur le récit un certain thématisme raisonné, dont Barthes lui-même, jusque dans sa période sémiologique la plus dure, ne s’est jamais défait. Un ouvrage comme La Montre cassée (2004) de Tiphaine Samoyault illustre bien tout ce que les théories de la narrativité peuvent aujourd’hui tirer d’une analyse patiente des figures et métaphores du temps qui traversent les textes. Ce que Blumenberg a baptisé « métaphorologie » pourrait d’ailleurs être adapté de manière à interpréter les images du temps qui préexistent à la mise en intrigue et qui éclairent la rationalité des pratiques narratives, même dans un univers de fiction. Les représentations de la naissance, de la mort et de la filiation portent évidemment un discours sur le temps comme expérience de la génération et de la corruption. Le recours à des indicateurs temporels — de l’horloge au calendrier, des rythmes biologiques aux phénomènes saisonniers — renvoie aux chronométries qui influent sur la perception individuelle et collective du temps. Les références à des événements historiques, à des discours idéologiques ou à des trames politiques (ce que Lyotard appelait des « grands récits ») permettent de reconstituer l’arrière-plan narratif sur lequel une intrigue se détache. On pourrait multiplier les exemples de figures, d’images et de signes qui participent de la narrativité d’un texte.
Je résumerai mon propos en disant que ma lecture repose sur deux présupposés méthodologiques. Premièrement, un récit est une médiation de l’expérience du temps, mais cette expérience est elle-même variable. Il faut donc non seulement identifier les structures et les procédés narratifs dans une perspective narratologique, mais rendre compte de leur pertinence par la reconstruction de l’expérience temporelle dont le récit porte la trace par différentes manifestations thématiques et figuratives. Deuxièmement, un récit est toujours en relation avec d’autres récits, auxquels il renvoie plus ou moins explicitement et desquels il tend à se distinguer. Les cas de figure sont nombreux. Une même série d’événements peut avoir été déjà agencée par d’autres récits et dès lors une intrigue première pourra être contestée par une intrigue seconde (Les Géorgiques racontent la participation de George Orwell à la Guerre d’Espagne autrement que le faisait Hommage à la Catalogne). Les personnages d’un récit peuvent être dépositaires de trames narratives qui guident leur agir, par exemple s’ils adhèrent à des récits idéologiques; l’intrigue, peu à peu, montrera les effets bénéfiques ou néfastes des schèmes d’action que colportent les récits véhiculés par les personnages (c’est ce que fait le récit historiographique du Dix-huit brumaire de Marx). Des modèles narratifs antérieurs, dotés d’une certaine influence et qui ont permis de configurer différents événements, peuvent être repris ou détournés, parodiés ou critiqués par un récit (Le Baphomet de Klossowski met ainsi à l’épreuve de la modernité la narrativité figurale par laquelle le christianisme avait défini son rapport au passé judaïque). En résumé, il faut, pour comprendre les textes narratifs et rendre raison de leur structure, 1) identifier l’expérience temporelle qu’ils ont pour fonction de configurer et dont ils exhibent les signes 2) reconstituer les mises en intrigue face auxquelles ils se situent et avec lesquelles ils entrent en tension. C’est ainsi que la dialectique de la question et de la réponse, qui soutient les rapports entre temps et récit selon Ricœur, peut être mise à profit dans l’analyse d’un texte narratif. Pour comprendre un récit, il faut identifier la question à laquelle il apporte réponse, ce qui signifie reconnaître l’expérience du temps à son origine et les mises en intrigue concurrentes.
À vrai dire, tout cela concerne la mémoire du récit. Un récit porte la mémoire du temps qu’il œuvre à configurer de même qu’il porte la mémoire des récits par rapport auxquels il prend position dans l’univers (réel ou fictionnel) qui est le sien. On peut traduire cela en affirmant que chaque récit doit être étudié comme le lieu d’une narrativité restreinte, notamment dans une perspective narratologique, mais que chaque récit porte les signes d’une narrativité générale qui constitue l’espace au sein duquel il prend sa signification pour qui l’analyse dans une perspective herméneutique. Il me semble que les théories de la narrativité doivent aujourd’hui redécouvrir la mémoire du récit et apprendre à nouveau à la déplier et à en distinguer les strates. C’est de cette manière, je crois, que l’on peut penser une historicité des pratiques narratives et se donner les moyens d’interpréter le récit comme un phénomène culturel porteur d’histoire. Car il ne suffit pas de décrire le comment de la narrativité, il faut aussi en comprendre le pourquoi. C’est la mémoire qui nous pousse de l’avant comme le disait Bergson — c’est par la mémoire du récit que l’on peut suivre le déploiement et les ramifications d’une histoire des pratiques narratives.
DG – La perspective que vous adoptez ouvre considérablement le champ de la réflexion sur les rapports du récit au temps historique. On en retire l’impression que l’investigation pourrait être relancée à partir d’autres récits. Comptez-vous donner suite à vos Revenances, y revenir ou les redéployer ?
JFH – Je travaille depuis quelques mois à un deuxième essai, dont le titre de travail, volontairement énigmatique, est « Camarade Mallarmé », en référence à un article polémique de Jean-Pierre Faye paru dans L’Humanité en 1969. Je m’y intéresse aux « politiques de la lecture » qui, de Sartre et Blanchot à Rancière et Badiou, en passant par Sollers et Kristeva, ont peu à peu transformé le poète par excellence de la tour d’ivoire en une vieille taupe que l’on a cru capable de miner les fondements de l’ordre social. Pendant un demi-siècle, la théorie française a en effet considéré Mallarmé comme un animal politique doté d’une puissance de subversion sans égale. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Roland Barthes se réclamait de la fonction utopique d’une modernité mallarméenne et parodiait la célèbre déclaration d’André Breton au Congrès des écrivains de 1935 : « "Changer la langue", mot mallarméen, est concomitant de "Changer le monde", mot marxien : il y a une écoute politique de Mallarmé, de ceux qui l’ont suivi et le suivent encore ». En 1991, le linguiste Jean-Claude Milner abordait les conséquences de la chute du régime soviétique en ces termes : « Mallarmé disait : "On a touché au vers"; on m’accordera peut-être qu’on a touché à Lénine.» À mes yeux, le camarade Mallarmé est une figure du souvenir dans laquelle la théorie française a condensé une pensée de l’histoire où la mémoire culturelle apparaît comme force de contestation. À chaque occurrence du camarade Mallarmé, c’est une expérience extrêmement complexe du temps qui est donnée à lire, ainsi qu’une stratification de souvenirs hétérogènes où s’entrelacent des segments de la modernité littéraire et de l’histoire politique des deux derniers siècles. L’enjeu est de comprendre ce que signifie lire politiquement la littérature du passé et de définir les déterminations historiques d’une telle entreprise. Quelle est la légitimité des anachronismes par lesquels Blanchot et Barthes associent Mallarmé à la terreur révolutionnaire? Comment comprendre que Sollers, Faye et Kristeva fassent de Mallarmé un héros de la génération 68? Pourquoi Badiou et Rancière le considèrent-ils comme un rempart contre le dépérissement de la vie politique en régime contemporain? À travers l’analyse de ces lectures de Mallarmé, c’est une certaine archéologie de la théorie française et de sa fascination pour la politique que je voudrais proposer. S’il n’en va pas de la narrativité à strictement parler, il s’agit néanmoins de reprendre à nouveaux frais la question des formes de l’histoire et des usages de la mémoire culturelle qui était déjà au cœur de mes Revenances.
Entretien publié le 12/11/2007